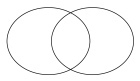Ce matin-là, à l’heure de pointe, j’ai suivi un chou-fleur et un gros navet. Ça va, on n’a pas tous le même horaire de vie, mais je trouvais drôle de porter sur mes épaules le poids d’un ordinateur et d’un deadline alors que l’homme devant moi transportait un petit sac de légumes beiges.
Le chanceux ne courait pas après les minutes et était même paré de culottes de jogging. Mais entre ma journée et celle que je lui tricotais dans l’équivalent du phentex, je préférais mon jeudi. C’est surtout parce que l’odeur du bouilli me ramène aux dimanches d’automne de mon enfance, que je scrappais de bord en bord dans l’anticipation du retour à l’école. Le soir, dans les effluves des plats que ma mère avait cuisinés pour la semaine, le thème des Beaux dimanches m’achevait avec son piano tragique et son «Mesdames et messieurs, bonsoir », l’indicatif officiel de la fin du bonheur. Tu pouvais donc aller te faire plaisir avec ta rabiole, gars. Je ne souffre pas de dépression saisonnière et on va garder ça comme ça.
Au tourniquet, j’ai oublié de sortir ma carte et je me suis payé ma fêlure mensuelle du pelvis. C’était quand même moins gênant que la fois où j’avais essayé de passer avec ma carte d’assurance-maladie. Bref, quand on ne peut pas compter sur la mémoire des gestes à 8h le matin, les ressources sont minces, et on craint pour le reste de la journée. Avec raison.
Le midi, en sortant de l’univers parallèle du Montréal souterrain, je suis passée devant un homme et son chien, assis sous une dizaine de couvertures. Ironiquement, ils étaient à quelques pas du ridicule Doggy Couture, un magasin qui, je l’espère, stimule le reflux gastrique chez la majorité d’entre nous. Sur ses genoux, une affiche : « Je m’appelle Frédéric. Je suis né le 28 novembre 1984. Aujourd’hui j’ai 30 ans. » Est-ce que c’était vrai? Peu importe. Mon coeur s’est engourdi sous l’uppercut. J’ai marché quelques coins de rues, de plus en plus lentement, puis j’ai fait demi-tour.
J’étais à un mètre de lui, à me demander ce que j’allais bien lui dire, guidée par tout sauf ma tête, quand un passant a involontairement donné un coup de pied dans son argent. Commotion. L’homme s’est levé, des gens se sont excusés, le timing n’était plus bon. Je n’ai pas su quoi faire, ce n’était pas dans l’ébauche de mon script. Dans la mêlée, j’ai pris quelques sous, les ai placés dans son verre puis lui ai souhaité bonne fête, timidement. J’ai regretté mes voeux absurdes alors que je les prononçais, parce que, eille, comme entrée dans la trentaine, on avait certainement vu mieux, mais il a levé la tête et m’a remerciée. J’ai marché jusqu’au travail, pas tellement bien dans mes bottes.
Le soir, à Laurier, un homme âgé m’a lancé un hochement de tête poli, un genre de bonjour ma petite dame en s’assoyant face à moi. On jouait soudainement devant la caméra de Gilles Carle, en 1972, dans une quincaillerie de région. J’ai répondu par un sourire, parce qu’on serait bête de ne pas rendre ceux qui ne s’échappent pas de faces de psychopathes. Peut-être aussi parce que, rendue là dans la journée, j’aurais préféré être en habit de neige une-pièce à écouter jaser des monsieurs comme mon père, dans un magasin général quelque part. Je commençais même à me raviser au sujet de l’option bouilli.
Décembre approchait, et il fallait trouver encore cette année une façon de le mettre à ma main.
J’ai fixé l’homme au teint grisâtre qui se tenait debout à la droite du monsieur rétro. Cette personne n’était pas en bonne santé. J’ai pensé à mon père, à cet instant où, assise avec lui dans le salon, j’ai compris que là, juste là, on empruntait du temps. Le combat était devenu visible en surface, dans son visage, dans la façon qu’avait le fauteuil de l’avaler. On a ensuite volé deux, trois semaines, pleines de ce cliché littéraire que je n’aimais pas, celui de l’homme plus grand que nature réduit à quelque chose comme une ombre. Jusqu’au 21 décembre.
Les yeux dans le brouillard, fixés sur les mains du passager au visage cendre, j’ai cligné fort pour chasser le souvenir de ma tête. Je n’avais pas besoin de revivre le moment, celui de la perte qui prend par surprise en se jouant avant le temps, plus violente que le vrai départ parce qu’on n’a jamais ressenti aussi fort qu’à cet instant des mots qui, si on les prononçait, briseraient le coeur du père qui n’a pas fini son travail de père : pars pas.
Wo. J’avais été sur le point de laisser un inconnu au mauvais teint me voler ma fin de journée. Uncue l’envolée dramatique des Beaux Dimanches, juste à temps. À Jean-Talon, je me suis levée, et en passant mon sac par dessus ma tête, j’ai souhaité bonne soirée au vieux gérant de quincaillerie, comme une première droite à décembre. Mon père était parti, mais il était partout.