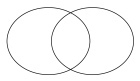Je remplissais mon bac à glaçons en le tenant en angle : l’eau coulait d’abord dans les deux premiers trous, puis inondait les suivants en cascade, et ainsi de suite jusqu’aux derniers. Je contrôlais une version miniature de l’escalier du géant, pour alimenter mon pays en glaces à cocktails.
J’ai quitté des yeux mon projet de société pour regarder par la fenêtre. Encore cette année, je trouvais charmant que des voisins aient installé des lumières de Noël à l’arrière de leur bloc pour désennuyer les cuisines autour. Chu d’même. Mon cynisme est une arme qui ne pèse pas lourd devant la beauté des petits gestes.
Le temps des fêtes remballait ses artifices, son arbre géant séché dans le coin de la salle à manger, les branches figées dans un angle fatigué. Sous la table du balcon, j’ai vu le goulot de la bouteille de champagne qu’on avait sabrée la veille. J’ai jeté un coup d’oeil rapide à la boîte de Vicks rouges qui traînait sur le comptoir, certaine pour la cinquième fois que c’était mon téléphone qui s’allumait sur un message. Je me suis essuyé les mains, j’ai pris une gorgée de café tiède, puis j’ai enfilé mes souliers de course. Mon corps criait non en pensant aux verres de bulles, mais fallait c’qu’y fallait.
Dehors, l’air frais m’a réveillée d’un coup, et j’ai couru d’un bon pas jusqu’au parc Jarry. Boutonnée jusqu’au menton, la tuque juste assez serrée, je croisais des coureurs au cou dégagé, réchauffés par le trajet. J’avais les pieds gelés et une couple d’autres kilomètres à faire avant d’avoir la tête vide, mais je comptais bien revenir l’âme et le manteau dézippés moi aussi.
On a beau savoir qu’il s’en vient, le néant sidéral du début janvier nous rentre toujours un peu dedans. J’ai évité une plaque de glace en me disant que celui de cette année n’était pas si mal, que rien n’était inatteignable sur ce qui commençait, après trois coins de rue, à ressembler à une courte liste de résolutions. Porter mes lunettes plus souvent devant un écran, j’étais presque certaine de pouvoir faire ça.
Il y a des années qu’on amorce avec l’impression de nager autour de l’endroit où on devrait se trouver, sans trop savoir comment changer l’ellipse, et on se décline alors une liste dans toutes les directions. Je ne pataugeais pas nécessairement dans une mer bleue et calme, mais mettons que l’eau se tenait entre 78 et 80, et que, sur la pointe des pieds, je touchais au fond. Ça me semblait pas mal pour un 2 janvier. Et aussi pour la suite des choses.
Revenir sur les quatre dernières saisons avant d’enligner les quatre prochaines, c’est une affaire d’adulte. En même temps, si, enfant, j’avais perdu du temps sur des rétrospectives annuelles, je me serais donné de grandes tapes dans le dos à chaque 31 décembre. Par exemple, assister à l’épluchette de blé d’Inde du Club Optimiste de Gatineau et voir un combat de la WWF à Cornwall le même été, voilà qui avait été une année faste doublée d’une franche réussite. OK, les attentes étaient moins grandes dans ce temps-là, où on s’émerveillait devant une chip ranch et où nager dans une piscine à 58 ne rimait pas avec infarctus ou amputation d’un testicule. Mais quand même, il y a peut-être une morale à l’histoire : pas de viser bas, mais d’apprécier les affaires moins grandes. Peut-être? Après tout, c’est dans les gradins de mon unique gala de lutte que j’ai compris que les adultes n’étaient pas nécessairement wise, surtout gréés d’un gros doigt en styromousse. Si ce ne fut pas le plus bel après-midi de ma vie, ce fut certainement celui d’une grande leçon.
Au nord du parc, après avoir confirmé l’utilité de mes lunettes, j’ai estimé qu’en 2015 je devais lâcher Facebook un brin. Eh boy. Comme liste, on avait vu mieux. Pire encore, c’était juste pour la forme, parce que j’allais sûrement échouer. Viser la haute direction de la Banque du Canada était plus réaliste qu’arrêter de me commettre quotidiennement sur un fond bleu et blanc, avec mes lunettes ou non dans la face. Il me restait trois kilomètres pour trouver autre chose. Mais est-ce que j’en avais vraiment envie?
J’ai bu une gorgée d’eau à côté d’un écureuil qui grignotait un bout de cheeseburger, en équilibre sur le bord d’une poubelle, pendant que dans les fenêtres du gym 24h au coin de la rue des hommes en ceintures de musculation soulevaient des poids aussi ridicules que leur ratio tête/cou. Je courais sur Death From Above 1979, et j’ai rejoint l’île du parc Jarry sur un yeah parfait, à 1:31 de Nothin’ Left.
Si j’avais pas eu peur de passer à travers la glace et de m’évanouir – pas obligatoirement dans cet ordre-là, merci à la Veuve Clicquot –, j’aurais sprinté sur l’étang gelé. Parce que je venais de trouver. Continuer à essayer de transformer les petites choses autour en plus grandes affaires, ça me semblait assez porteur comme résolution. Les autres cases se rempliraient ensuite toutes seules, comme dans un bac à glaçons.
![photo[1]](https://www.daniellesurleterrain.com/wp-content/uploads/2015/01/photo1-300x259.jpg)